Chili
Résidence à Marseille
Avec le soutien de l’Institut français à Paris et de la Ville de Marseille.
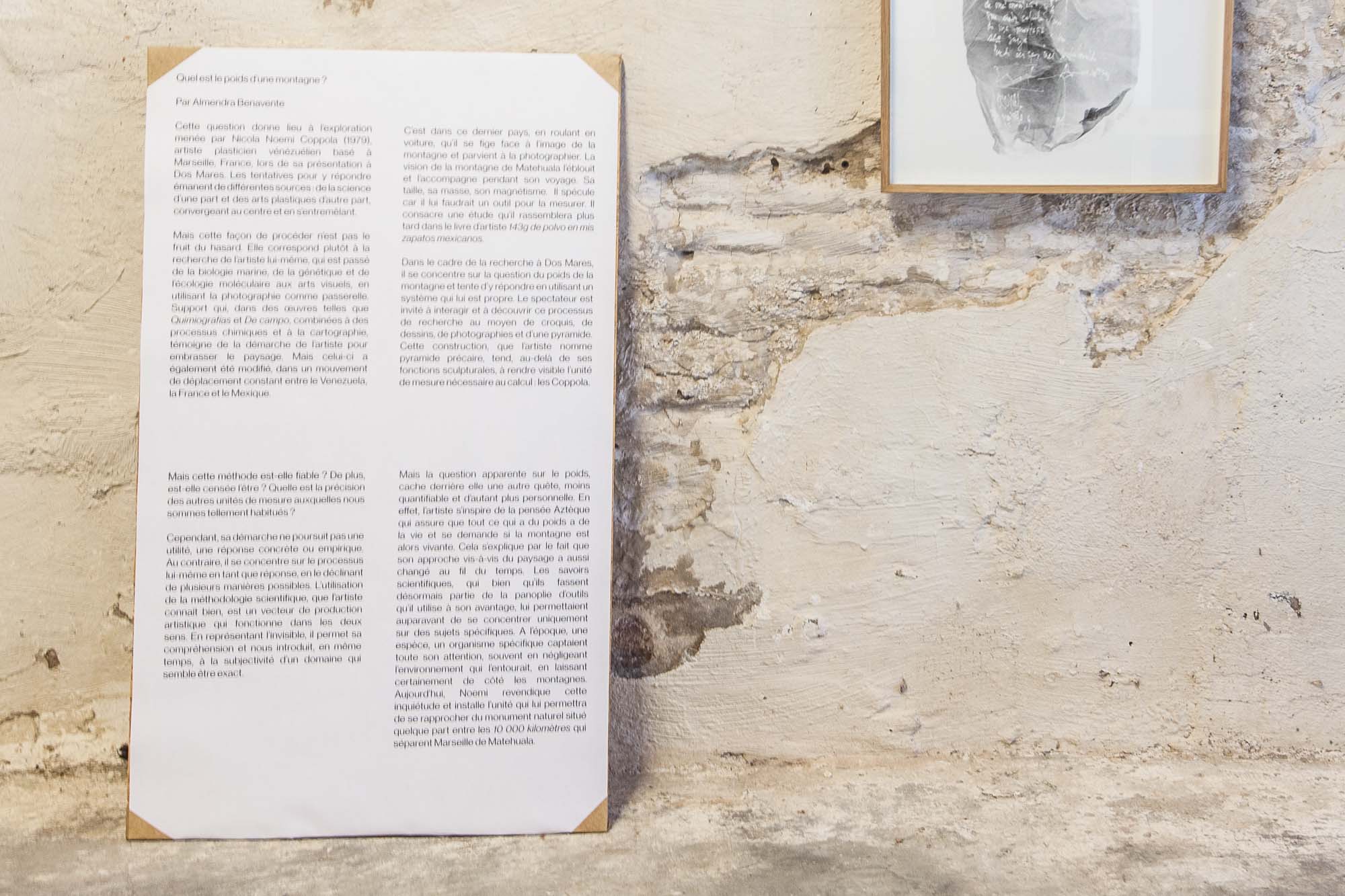
Almendra Benavente (Chili) sera en résidence d’écriture jusqu’au 30 août, elle travaillera à l’analyse critique des propositions des artistes invité·e·s en résidence à Dos Mares. Elle presentera ses recherches textuelles et les pistes développées lors d’une rencontre avec le public.
Auteure et éditrice, spécialisée dans le milieu de l’art et la culture, elle a suivi des études au Chili et en France. Travaillant dans l’écriture, l’édition et la traduction de monographies d’artistes, elle a réalisé des critiques pour des médias tels qu’Artishock et SIP de Julio Artist Run Space. Co-directrice de *maison trouvée*, maison d’édition d’objets d’art et de livres d’artistes, elle a aussi coordonné des projets d’édition au sujet de la muséographie et les expositions d’art, développant, en même temps, ses propres projets d’écriture. Elle a fait partie d’une résidence artistique au ZKM et KIT, à Karlsruhe, Allemagne, pour la recherche et la production d’une monographie bilingue.
Oublie tout ce que tu sais*
Par Almendra Benavente
L’été dernier, j’ai eu l’occasion de visiter La Ciotat, ville paisible abritée par des falaises à l’est de Marseille. Lors de mon séjour, j’ai appris que les frères Lumière y avaient réalisé l’une des premières projections de films et que l’un de leurs premiers métrages – qui avait d’ailleurs bouleversé le public – était précisément l’image du train entrant en gare de la ville. On attribue aux frères Lumière la création du cinéma. Enfin, c’est ce que je savais.
Mes amis locaux avaient appris, en revanche, que le créateur était plutôt Thomas Alva Edison. Une fois le débat ouvert et après les recherches correspondantes, dont une mention à Jean Le Roy, nous sommes arrivés à diverses conclusions : les frères Lumière ont réalisé les projections qui ont donné lieu au cinéma que nous connaissons aujourd’hui, mais Edison est à l’origine du mécanisme qui a rendu cela possible. Il n’y avait pas pour autant une seule réponse, mais encore plus de questions : qui avait donc créé le cinéma ? Par ailleurs, quand est-ce qu’on peut dire qu’une découverte a-t-elle vraiment eu lieu ?
Je me souviens alors de mes études en Histoire à l’université au Chili. La première leçon en classe fut : oubliez tout ce que vous savez. Ce cours est appelé “Historiographie”, car l’histoire est racontée par ceux qui l’écrivent. Ou ceux qui gagnent ou s’imposent face aux autres. Et quelles histoires sont racontées en Amérique latine ? Qui a découvert quoi et quand ? La découverte de l’Amérique a été l’une des premières choses que j’ai dû oublier. Ou corriger.
L’histoire d’Hercule Florence s’inscrit dans cette même recherche. Non celle d’une vérité ultime, mais plutôt des diverses vérités qui existent pour raconter une histoire.
Dès ses premiers enseignements, Livia Melzi, artiste plasticienne née à São Paulo, apprit que la photographie avait été découverte par Florence au Brésil. Immigré français arrivé en 1824, il s’est consacré à illustrer la nature brésilienne et à expérimenter avec du nitrate d’argent et une chambre noire. Mais, au bout du compte, son histoire n’a pas fini d’être écrite, car les négatifs qu’il envoyait aux laboratoires européens arrivaient toujours vierges. Comme les images qu’il n’a pas pu regarder, son histoire s’est évanouie, obtenant peu de reconnaissance de son vivant, mais étant à jamais gravée dans l’esprit des habitants du Brésil.
Après s’être spécialisée en océanographie et en photographie, Livia Melzi s’est installée à Arles. À l’époque, elle s’est rendu compte que tout le monde parlait de photographie mais sans jamais mentionner Florence. Sur ce continent, l’inventeur était Niepce, même si ce fut dix ans après les expériences du Français au Brésil. Il est devenu donc l’un des nombreux personnages de la mythologie latino-américaine qui habitent notre continent, simplement parce que l’histoire qui nous a été racontée était une autre.
Afin de démêler ses souvenirs, Melzi décide alors de retracer les pas du photographe au Brésil. Dans cette quête, elle se rend dans les lieux qu’il visita autrefois. Elle recrée ensuite dans Devenir Hercule Florence (2015) un cabinet de curiosités, exposant ses reliques et invitant un saxophoniste à interpréter la zoophonie de Florence, composition qu’il a faite du chant des oiseaux dans ce pays. En ravivant ses découvertes, elle les fait vivre à travers un autre.
Plus tard, dans Terra Papagalli (2016- 2018), œuvre qui fait partie du Musée d’histoire naturelle de France, l’artiste décide comment elle veut représenter son pays d’origine, en renonçant et en détournant l’imagerie colonialiste du perroquet de Terra dos Papagaios, nom que les Européens donnaient au Brésil. Au moment de l’empailler, elle y introduit un message en coulisse pour l’avenir : une capsule temporelle avec des informations cryptées pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin. Le Brésil, décidément, ce n’est pas seulement des palmiers et des perroquets.
Pendant sa résidence à Dos Mares, Melzi explore la construction artistique et identitaire de l’Amérique latine à travers des objets chargés du poids du colonialisme européen. Dans Qu’il était bon mon petit Français (2019-2020), elle fait référence au film du Cinema Novo qui parle de l’arrivée d’un Français qui, à l’époque de la colonisation, est accueilli par les Tupinambá puis dévoré selon un rite cannibale.
À cette occasion, l’artiste laisse derrière elle le sujet du cannibalisme, qui pendant des années a servi à alimenter des mythes sur son pays et se concentre plutôt sur la recherche des manteaux de la tribu Tupinambá, qui cachent derrière eux un scenario plus complexe et inconnu.
Au XVIe siècle, les colonisateurs européens ont d’abord ordonné la destruction des manteaux, avant de les usurper et de les apporter à l’aristocratie en Europe en tant que cadeaux exotiques. Les manteaux de plumes sacrés, symbole de la résistance des Tupinambá, sont actuellement exposés dans leur intégralité dans des institutions européennes, à défaut d’exemplaires dans leur pays d’origine. Melzi s’interroge ainsi sur l’accès au propre patrimoine ; le rôle des musées ; invention européenne, non seulement comme entité de conservation, mais aussi comme dispositif de pouvoir.
Afin de libérer de l’espace dans notre mémoire et poursuivre l’exercice de réécrire notre propre histoire, il a fallu vider et rompre avec ces symboles qui la bloquaient. Nous le constatons aujourd’hui dans les rues, avec la chute de monuments qui exaltent des personnages historiques qui ne méritent pourtant pas d’être rappelés. L’artiste s’inspire de ces faits, en projetant des vidéos de l’exil de statues emblématiques lors des mouvements sociaux, et ce en Amérique Latine mais aussi dans différentes parties du monde.
En parallèle, elle aborde la découverte du buste de Jules César dans la vallée du Rhône. Buste du personnage mythique de la culture européenne, récupéré après avoir été submergé pendant plusieurs siècles – probablement suite à son expulsion par les habitants d’Arles, où le buste reposait à l’origine– il est finalement reconsacré aujourd’hui.
La destruction des symboles de pouvoir n’est pas donc récente, peut-être fallait-il seulement s’en souvenir.
*Texte réalisé en août 2020 lors d’une résidence à Dos Mares dans le cadre du Printemps de l’Art Contemporain (PAC) à Marseille.
—
Entretien avec Martin Kaulen
Par Almendra Benavente
Août 2020
Dans quel projet de recherche travailles-tu actuellement ?
Je recherche des références aux cultures précolombiennes associées au horizonte temprano, dans lesquelles il y a des symboles issus de l’expérience avec des plantes hallucinogènes. Je m’intéresse en particulier à la culture Chavín, qui a exercé une domination passive sur les autres cultures, en se basant sur le rituel de l’Achuma –appelée aussi San Pedro par les Espagnols– développant ensuite toute une iconographie associée. Je considère important de confronter les idées des peuples précolombiens dans la situation de crise actuelle, par rapport à leur relation avec la nature, leur proximité avec la terre et ses cycles.
Je cherche également à me démarquer du regard judéo-chrétien avec lequel j’ai grandi et été éduqué, afin de revaloriser l’identité des peuples originaires qui habitent l’Amérique latine. Pour l’histoire de l’art classique, tout ce qui est produit par ces cultures devrait être également valorisé. Tout comme la Mésopotamie a été à l’origine de certaines civilisations, au Pérou se trouve la culture Caral. Et pourquoi n’en parle-t-on pas ? Est-ce à cause de son éloignement de l’Europe ?
Quelles sont les références qui inspirent ta démarche artistique ?
Les cultures Chavín, Cupisnique, Mochica et Lambayeque. Les sites archéologiques de Chavín de Huantar, Sipan et Caral. Les géoglyphes. Je m’intéresse également au travail d’installation de Helio Oiticica, au croisement des matériaux et à la réminiscence d’un paysage urbain mais aussi naturel.
Comment se déroule ta recherche, quelle méthodologie utilises-tu pour approfondir les sujets qui t’intéressent ?
Je consulte des recherches sur des sites archéologiques, ses habitants et leur modes de vie. Ces références sont un point de départ pour la production de mon œuvre.
Je suis intéressé par l’apprentissage de nouvelles techniques et la découverte de nouveaux matériaux. Je me sers de la façon de procéder utilisée dans un autre métier et je l’applique à un support différent.
Sur quel projet travailles-tu pendant ton séjour à Dos Mares ?
Je travaille sur une installation composée d’éléments en céramique et en plâtre qui apparaissent sur le sable, comme des objets trouvés, comme lors d’une fouille archéologique. Les objets sont ensuite projetés sur le sable et le sol, empruntant tout l’espace de la salle. Je fais référence à des sites archéologiques qui sont endommagés par l’action humaine, comme c’est le cas des géoglyphes au Chili et au Pérou.
La question de l’identité et du territoire a été un sujet de réflexion lors de cette résidence. Comment penses-tu que ton identité latino-américaine se traduit dans ton travail artistique ?
Tous les motifs préhispaniques avec lesquels j’ai grandi, que j’ai pu voir dans mes voyages, l’artisanat du Chili, de l’Amérique latine, chaque lieu a été capturé dans mon identité, et résonne dans ma conscience, comme un écho. Je pense qu’il est très différent de venir d’une ville européenne que de venir d’Amérique latine, où il y a une grande coexistence et une grande présence des peuples originaires.
Parfois, je me demande ce que c’est que d’être chilien. Est-ce venir d’une ville avec toute cette culture occidentale qui est imposée, ou le produit d’un grand mélange de peuples issus de différents endroits ? Le produit des guerres, des colonies. Ce mélange de cultures différentes converge et rend la notion d’identité difficile. Chacune de ces identités est présente, mais en fin de compte, on ne fait partie d’aucune d’entre elles.
Quel rôle jouent la distance et le territoire dans ton travail ?
Les distances à parcourir ont conduit à une production fragmentée de ma démarche artistique. Certaines pièces sont produites dans mon atelier, d’autres sont réalisées sur place. Il y a des pièces que je réalise à travers de longs processus : céramique, modelage, cuisson, émaillage, qui coexistent avec d’autres réalisées de manière plus spontanée.
Assumer le rôle de sculpteur nomade a toujours été un défi pour moi. J’ai un nombre limité d’éléments que je peux transporter, dont beaucoup sont assez fragiles. Mais cela m’a aussi obligé à adapter le format, de nombreuses pièces sont pliables ou dessinées.
Comment penses-tu que l’exotisme se manifeste de l’Europe à l’Amérique latine ?
Parmi les idées que j’ai développées pendant la résidence, il y a ce que je définis comme de l’extractivisme culturel, qui est l’usurpation de concepts et d’éléments identitaires, leur faisant perdre leur usage original. Des marques telles que Quechua, Inca, Patagonia et Quilmes, sont utilisées à des fins commerciales, ce qui les sépare de leur origine et de leur signification.
Je crois qu’en Amérique latine, on vit l’expérience culturelle d’un autre. Les chefs-d’œuvre sont produits en dehors de notre continent, en tant que latino-américains on est toujours très éloigné d’eux. Il existe une fragmentation entre l’éducation artistique, guidée par un regard étranger, et une production culturelle abondante mais dans des contextes de création généralement précaires.
Quel est le poids d’une montagne?
Par Almendra Benavente
Cette question apparente donne lieu à l’exploration menée par Nicola Noemi Coppola (1979), artiste plasticien vénézuélien basé à Marseille, France, lors de sa présentation à Dos Mares. Les tentatives pour y répondre émanent de différentes sources : de la science, d’une part et des arts plastiques d’autre part, convergeant au centre et en s’entremêlant.
Mais cette façon de procéder n’est pas le fruit du hasard. Elle correspond plutôt à la recherche de l’artiste lui-même, qui est passé de la biologie marine, de la génétique et de l’écologie moléculaire aux arts visuels, en utilisant la photographie comme passerelle. Support qui, dans des œuvres telles que Quimiografías et De campo, combinées à des processus chimiques et à la cartographie, témoigne de la démarche de l’artiste pour embrasser le paysage. Mais celui-ci a également été modifié, dans un mouvement de déplacement constant entre le Venezuela, la France et le Mexique.
C’est dans ce dernier pays, en roulant en voiture, qu’il se fige face à l’image de la montagne et parvient à la photographier. La vision de la montagne de Matehuala l’éblouit et l’accompagne pendant son voyage. Sa taille, sa masse, son magnétisme. Il spécule : il lui faudrait un outil pour la mesurer. Il consacre un étude qu’il rassemblera plus tard dans le livre d’artiste 143g de polvo en mis zapatos mexicanos.
Dans le cadre de la recherche à Dos Mares, il se concentre, à première vue, sur la question du poids de la montagne et tente d’y répondre en utilisant un système qui lui est propre. Le spectateur est invité à interagir et à découvrir ce processus de recherche au moyen de croquis, de dessins, de photographies et d’une pyramide. Cette construction, que l’artiste nomme pyramide précaire, tend, au-delà de ses fonctions sculpturales, à rendre visible l’unité de mesure nécessaire au calcul : les coppoles. Mais cette méthode est-elle fiable ? De plus, est-elle censée l’être ? Quelle est la précision des autres unités de mesure auxquelles nous sommes tellement habitués ?
Cependant, sa démarche ne poursuit pas une utilité, une réponse concrète ou empirique. Au contraire, il se concentre sur le processus lui-même en tant que réponse, en le déclinant de plusieurs manières possibles. L’utilisation de la méthodologie scientifique, que l’artiste connaît bien, est un vecteur de production artistique qui fonctionne dans les deux sens. En représentant l’invisible, il permet sa compréhension et nous introduit, en même temps, à la subjectivité d’un domaine qui semble être exact.
Mais la question apparente sur le poids, cache derrière elle une autre quête, moins quantifiable et d’autant plus personnelle. En effet, l’artiste s’inspire de la pensée Aztèque qui assure que tout ce qui a du poids a de la vie, et se demande si la montagne est alors vivante. Cela s’explique par le fait que son approche vis-à-vis du paysage a aussi changé au fil du temps. Les savoirs scientifiques, qui bien qu’ils fassent désormais partie de la panoplie d’outils qu’il utilise à son avantage, lui permettaient auparavant de se concentrer uniquement sur des sujets spécifiques. Une espèce, un organisme spécifique captaient toute son attention, souvent en négligeant l’environnement qui l’entourait, en laissant certainement de côté les montagnes. Aujourd’hui, Noemi revendique cette inquiétude et installe l’unité qui lui permettra de se rapprocher du monument naturel situé quelque part entre les 10 000 kilomètres qui séparent Marseille de Matehuala.